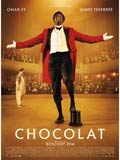Le Grand Homme de Sarah Leonor avec Jérémie Rénier en VOD et DVD
Synopsis
Détachés en Afghanistan pour 6 mois, les légionnaires Markov et Hamilton sont pris en embuscade lors d’une expédition non autorisée par leur hiérarchie.
Markov sauve Hamilton, grièvement blessé par des tirs rebelles, mais quitte la Légion sans les honneurs.
De retour à Paris, Hamilton, convalescent, souhaite rester légionnaire, tandis que Markov, désormais civil et sans papiers, tente de s’en sortir avec son fils Khadji. Hamilton prête son identité civile à son ami tchétchène, pour qu’il puisse travailler légalement. Mais un jour, Markov disparaît, laissant Hamilton désorienté et Khadji seul au monde.
![]()
Entretien avec la réalisatrice Sarah LEONOR conduit par Frank Beauvais pour BAC FILMS

Après AU VOLEUR, LE GRAND HOMME est votre deuxième long-métrage. Qu’est-ce qui vous a amenée à développer ce projet ?
C’est, à la base, quelque chose de très personnel. J’ai été marquée par des disparitions très violentes, parce que très subites, dans mon entourage. Le décès de Guillaume Depardieu juste après AU VOLEUR, et puis celui, un an auparavant, de mon père. La question de la mort ne s’était, jusqu’alors, pas imposée à moi. C’est dans ce contexte intime que j’ai découvert la traduction de l’épopée de Gilgamesh par Jean Bottéro. Le mythe date du IIIe millénaire avant J.-C., avant Homère, avant la Bible. Gilgamesh est roi d’Uruk, une ville de Mésopotamie. Il se croit l’égal des dieux. Pour lui faire comprendre sa condition de mortel, ceux-ci lui envoient Enkidu, un étranger aussi fort et grand que lui. Ils commencent par se battre. Le combat ne les départage pas et ils deviennent amis, inséparables. Ensemble, ils accomplissent des exploits qui renforcent le royaume, aident le peuple d’Uruk. Un jour, Enkidu est frappé d’un mal inexplicable et meurt. À travers la disparition de son ami, Gilgamesh se retrouve confronté à l’inéluctabilité de sa propre mort, qu’il refuse. Un sentiment dépressif l’envahit. Il se met à voyager, cherchant l’immortalité. Dans son errance, il ne trouve aucune réponse, si ce n’est l’idée qu’en tant qu’homme, il ne peut échapper à sa finitude, quoi qu’il arrive.
Cette histoire provient de tablettes d’argile, trouvées aux quatre coins de la zone qui, en arc de cercle, court de la Mésopotamie à la Turquie. C’est un récit extrêmement elliptique, plein de trous, d’interruptions.
Sa lecture a été d’un réconfort immense pour moi. Et surtout, m’a convaincue que l’idée de la mort est une idée avec laquelle il faut savoir vivre, presque comme une amie. Qu’il faut apprendre à connaître. C’est la seule manière d’être en paix avec elle. Accomplir sa vie, c’est accepter l’idée de sa mort…
Votre film serait donc une transposition du mythe ?
Je me suis demandée ce que pouvait donner la confrontation du mythe à la réalité d’aujourd’hui. Le royaume d’Uruk serait la France.
L’action serait centrée à Paris, et Enkidu serait un homme venu d’ailleurs, de par-delà les frontières de Schengen. Qu’est-ce que cela donnerait ? Comment le traduire en termes contemporains ?
Les deux héros sont des guerriers. Il m’est donc venu la nécessité d’en faire des guerriers d’aujourd’hui. L’armée française m’intéressait depuis quelques années. Comme elle est désormais une armée de métier, je me demandais ce qui poussait des gamins à embrasser une carrière militaire. Quelle est leur motivation ?
Symboliquement, qu’est-ce que cela veut dire pour eux ?
Pour transposer la relation citoyen / non-citoyen du mythe, la Légion étrangère m’est apparue comme le cadre idéal. Ce n’est pas pour autant un film sur la Légion, ce n’est qu’un des points de départ.
Vous êtes donc partie d’une problématique intime pour aboutir à un récit qui aborde des questions plus larges de frontières, de citoyenneté et d’identité.
Oui, c’est ça. Ce qui m’affecte intimement est un point de départ, à partir duquel je regarde ce qui m’entoure.
Vous confrontez plusieurs univers. Comment s’est passé le travail de documentation ?
Ce film aborde des domaines qui m’étaient initialement totalement étrangers. J’ai vu et lu beaucoup de choses autour des guerres actuelles. Beaucoup de témoignages de soldats. Quand on n’est pas familier d’un univers, il faut vraiment lire à foison pour pouvoir décrire le plus justement possible un personnage qui entre, s’assied,
pose sa ceinture et défait ses lacets. C’est assez indispensable.
Vous avez rencontré des légionnaires ?
Je voulais rester libre dans l’écriture, garder une certaine distance. D’une part parce que la Légion n’est pas le sujet principal du film, d’autre part, je sais que la parole circule difficilement dans ce milieu. L’omerta est immense. Je n’avais pas envie de tomber dans des problèmes qui, même s’ils m’intéressaient, ne pouvaient que me compliquer la tâche. Je n’ai donc pas rencontré de légionnaire pendant l’écriture, mais plus tard, pour la préparation, j’ai travaillé avec Daniel Fassi, ancien Légionnaire, qui a immédiatement compris le projet. Il est devenu mon référent pour toutes les questions militaires. Grâce à lui, nous avons pu rester précis et réalistes et éviter de basculer dans un fantasme de violence ou de puissance qui, non seulement n’était pas en accord avec la réalité, mais ne faisait pas sens.
Un des autres univers se fixe autour de la Tchétchénie…
Je connaissais la région du Caucase, pour y avoir travaillé et voyagé. Le choix d’un personnage tchétchène s’est fait dès le scénario. En me renseignant sur la guerre en Tchétchénie, en lisant la nouvelle Hadji-Mourat de Tolstoï et d’autres écrits, je me suis rendue compte que c’était un pays où l’homme est vraiment une incarnation de la masculinité, du courage. Il y a dans la culture tchétchène une glorification du guerrier assez forte. Une image de bravoure, de protection des proches. Quelque chose de très droit et noble, encore aujourd’hui.
Et de très archaïque aussi…
Oui. C’était pour moi l’endroit où faire le point de jonction avec Gilgamesh. Je suis entrée dans la communauté tchétchène sur ce fil ténu. La documentation n’a jamais été aussi riche qu’au moment du casting, où j’ai pu me confronter à la communauté. Plein de choses ont été réécrites à ce moment.
Que cherchiez-vous pour le personnage d’Hamilton ?
Comment est arrivé Jérémie Renier ?
Le personnage d’Hamilton est complexe. Il est à la fois aguerri dans un contexte militaire et immature affectivement. Il est puissant en interaction avec Markov, mais totalement démuni lorsqu’il se retrouve seul. C’est un homme qui ne sait pas qui il est véritablement, et qui, dans le déroulement du film, va accéder à sa propre identité. Il faut, pour l’interpréter, une palette de jeu très étendue, en plus d’un physique crédible. Un légionnaire n’est pas forcément une boule de muscles, mais il faut tout de même être pourvu d’une densité physique forte.
Jérémie Renier est l’un des acteurs les plus intéressants de sa génération. Il a travaillé, sans a priori, dans des registres très divers: le réalisme, avec les frères Dardenne bien sûr mais aussi la comédie, le film d’aventure, le film noir… Il a un jeu très riche, à la fois physique et intérieur. Le scénario lui a beaucoup plu et il a donné très vite son accord. Cela ne lui faisait pas peur de travailler avec des acteurs non-professionnels, de jouer avec quelqu’un qui ne parlait pas français, qui avait appris tous ses dialogues phonétiquement. Ce qui m’a le plus renforcée dans l’idée que Jérémie était le bon choix, c’est son humilité par rapport au personnage. Il n’a pas cherché à rendre Hamilton plus intéressant qu’il n’est, à le rehausser. Jérémie a également une capacité de transformation extraordinaire. Du fait que son alter ego est brun, je lui ai demandé de se teindre les cheveux. À partir du moment où il était teint et qu’on lui a rasé la tête, j’ai découvert la dureté de son visage. C’était Hamilton. Il a laissé libre cours à une profondeur un rude, qui se dégage dans le film.
Pour les autres acteurs principaux, vous avez fait le choix de tourner avec des acteurs non-professionnels
tchétchènes. Comment sont-ils arrivés sur le projet ?
C’était impossible d’envisager des acteurs non tchétchènes pour les rôles de Markov/Mourad et son fils Khadji. Grâce à l’aide précieuse d’Issita Arslanov, qui joue dans le film le rôle de la femme qui recueille Khadji, Sarah Teper, la directrice de casting, et moi-même, avons pu entrer en contact avec la communauté.
Le concours d’Issita était essentiel : les Tchétchènes en ont marre d’être assimilés systématiquement à l’intégrisme musulman et au terrorisme, ils étaient plutôt sur la défensive, et la présence d’Issita, qui leur expliquait patiemment l’argument du film les rassurait. Les Tchétchènes forment une diaspora récente. La communauté est restée soudée grâce à Internet, via les réseaux sociaux et des sites dédiés à l’actualité des Tchétchènes dans le monde. Avec Issita, on a fait paraître des annonces et on a rapidement eu des retours. Des photos sont venues d’un peu partout. À chaque fois que l’on trouvait un visage intéressant, on commençait une conversation sur Skype. Quand on sentait que ça pouvait accrocher, on se déplaçait. J’étais au départ assez sceptique au sujet de la méthode « Skype ». Pourtant ça a très bien fonctionné: la première fois que j’ai vu l’image du petit Ramzan, comme celle de Surho, que j’ai entendu leur voix, et senti leur présence, j’ai su que, s’ils étaient capables de jouer devant une caméra, ce serait eux. Avec Sarah Teper, on est donc allées rencontrer Ramzan à Bruxelles. Les premiers échanges étaient assez drôles. Quand on lui a demandé s’il avait envie de jouer dans un film, il nous a répondu : « Non » ! Du coup on était un peu désarçonnées. Alors il nous a dit : « Je ne sais pas si ça va me plaire, puisque je ne sais pas ce que c’est. ». C’est tout Ramzan : il répond toujours très logiquement, et dit ce qu’il pense. Il n’essaie pas de séduire, il reste un enfant, et ça m’a plu.
Vous aviez donc trouvé l’enfant avant l’acteur adulte?
Oui. Surho Sugaipov, qui interprète Markov, est un parent éloigné de Ramzan.
La difficulté pour le rôle masculin adulte était que je cherchais un homme tchétchène qui incarne cette idée de bravoure, de souveraineté quelles que soient les circonstances. Or, j’ai rencontré beaucoup d’hommes qui étaient brisés par la guerre. Des hommes de 30, 35 ans, adolescents à Grozny pendant le conflit, qui avaient vécu des atrocités, et qui, aujourd’hui, étaient encore profondément traumatisés. Certains m’ont dit « Mais moi, je suis un homme mort. Ma vie est derrière moi. Je suis là uniquement pour les enfants. »
C’était poignant. Je me suis rendue compte à quel point la guerre avait vidé ces hommes de leur substance. Surho avait 13 ans au moment où il a quitté Grozny. Il a échappé à ça. C’est un garçon très ouvert. Un Européen, resté très Tchétchène. Profondément musulman, pratiquant. Il a une structure interne extrêmement solide, dans l’échange. Aux essais, il était intelligent, fin. C’était ce que je voulais pour le personnage. Je lui ai spécifié qu’à aucun moment, le personnage de Mourad ne devait donner l’impression de se sentir victime. Ce qu’il a incarné. Libre au spectateur d’imaginer ou non qu’il est la victime d’un système absurde.
Surho et Issita m’ont énormément apporté sur toute l’écriture de la partie tchétchène. Il y avait des choses impossibles à faire culturellement pour eux, ne serait-ce que la manière de se dire bonjour quand on ne s’est pas vu depuis cinq ans. On ne tombe pas dans les bras l’un de l’autre. La pudeur, toujours. L’idée aussi
que l’on peut dire des choses importantes, mais pas tout de suite.
Et quand on les dit on ne se regarde pas dans les yeux. On ne se touche pas. Plein de choses comme ça, qui ne correspondaient pas à ce que j’avais écrit. Qui relevaient d’une vision occidentale
de la culture tchétchène.
Vous avez travaillé avec le chef opérateur Laurent Desmet. C’est votre quatrième collaboration.
Mes deux premiers films, LES LIMBES et NAPOLI se sont faits sans lui. Il est arrivé pour L’ARPENTEUR, puis
LE LAC ET LA RIVIÈRE et AU VOLEUR. LE GRAND HOMMEest mon premier film numérique, d’où une certaine angoisse. Laurent m’a rassurée. Nous avons considéré ensemble les avantages et les inconvénients que cela pouvait comporter. L’économie du film joue un rôle absolument déterminant. On n’a pas forcément tous les éclairages que l’on veut, le temps de travail est forcément restreint… Avec Laurent, nous définissons donc toujours de grandes lignes, qui ne portent pas forcément sur les couleurs mais plutôt sur des atmosphères liées à la dramaturgie et sur un angle économiquement rationnel, permettant que le film se fasse au mieux.
Compte tenu de ces contraintes, le repérage prenait une importance capitale. Il fallait tourner par tous les temps quoi qu’il arrive. L’habitude et le plaisir que j’ai avec Laurent d’attendre la bonne
lumière, d’être dans une communion avec le décor, le ciel, les nuages n’étaient pas envisageables. Nous avons évolué dans une écriture cinématographique assez simple. C’est un film très proche des visages. Avec si peu de moyens, je suis contente du résultat. Laurent, comme moi, vient de la pellicule. Nous ne nous sommes pas dit, comme le veut une certaine tendance actuelle, que nous nous reposerions sur la post-production pour régler tous les problèmes. Notre côté vieille école nous pousse à affronter ces problèmes de front, dès le tournage.
Nous aimons bien travailler sur des couleurs dominantes. Le décor du café a été choisi parce qu’il était rouge. Nous avons cherché longtemps une morgue « contemporaine », c’est à dire aseptisée, froide métallique. Il fallait trouver le décor préexistant puisque nous n’avions pas les moyens de le faire construire. Le décor de l’appartement où se passent beaucoup de scènes déterminantes est volontairement très lumineux, avec une découverte sur Paris. C’est un espace que l’on voulait modulable avec Laurent. Par un jeu de bâches et de draps, chaque séquence dans l’appartement a une tonalité différente, en fonction de ce qui s’y passe.
Filmer le léopard était plus compliqué. On ne pouvait pas le filmer en extérieurs, cela nécessitait une infrastructure conséquente. Nous avons cherché une astuce pour rendre tout de même à l’animal son aspect sauvage, dangereux. Nous l’avons filmé de nuit, en intérieur, comme une image rêvée. Pour cette scène nous sommes sortis du registre réaliste. C’était un moment important pour moi qu’il
fallait conserver : sortir d’une narration classique et être dans un mode plus contemplatif, onirique. Laurent a capté les pupilles très lumineuses de l’animal, révélant la bête, le monstre de la mythologie.
Vous êtes très économe des effets de forme, ils sont donc particulièrement identifiables. La scène du léopard, le flou sur Hamilton après la mort de Markov, les travellings…
Lorsque Markov meurt, Hamilton devient un fantôme et perd littéralement son identité, puisqu’il meurt avec son propre nom. Il y a un jeu scénaristique appuyé qui doit être dit par le personnage mais aussi par la mise en scène, par le mouvement de caméra, par le son. C’est un jeu métaphorique qui m’intéresse. J’ai besoin de
ces moments-là qui n’appartiennent qu’au cinéma.Les trois travellings dans le film sont lents, descriptifs. Ils ne veulent pas dire autre chose que ce qu’ils montrent, mais forment un arc : on a le légionnaire vivant, on a le légionnaire éclopé, on a la tombe à la fin. Ce sont des choix qui se sont imposés aux repérages. Je n’écris pas de découpage. Je travaille avec des éléments concrets: « cette baie vitrée appelle un travelling, ces tombes musulmanes également, et cette cérémonie à la légion aussi ». C’est venu comme ça. La récurrence de ce mouvement exprime quelque chose qu’on ne peut pas dire avec des mots, et qu’il m’intéresse moins de filmer à travers une scène dialoguée. C’est pour cela que je fais du cinéma, sinon je le dirais avec un texte, ce qui coûterait moins cher…

Pour la musique, vous avez travaillé pour la première fois avec Martin Wheeler.
Je connaissais Martin à travers ses compositions pour Arnaud Des Pallières. Dans les films d’Arnaud, il parvient à créer une atmosphère qui préserve le son direct. Cette fusion respectueuse m’impressionne et m’intéresse.
Nous avons tout de suite travaillé par élimination. Je ne voulais pas de musique sur des gens qui marchent dans la rue, pour rythmer ou apposer une sorte de lyrisme facile. Je ne voulais pas de world music pour souligner la présence des Tchétchènes. Martin a rajouté : « Je ne veux pas d’instruments du XIXe ‘’bourgeois’’ », parce que cela ne correspondait pas à l’origine sociale des personnages. On était d’accord sur l’idée d’une musique sans référence classique. Nous
avons identifié à quels moments il fallait de la musique et quel était son statut dans ces moments-là. Je lui ai demandé que la musique accompagne des moments intimes de chacun des personnages,
mais qu’elle ne commente jamais l’action.
On sent plus que la musique a une nécessité quasi-organique, qui s’ouvre à l’image.
Elle part de l’image pour rayonner, mais elle ne part pas d’au-dessus pour l’englober. Elle jaillit de l’image et non l’inverse.
Oui. J’étais très heureuse de cela. Très vite, il était important pour nous deux que Martin rencontre Philippe Grivel et Jeanne Delplancq, les monteurs son, et assiste aux séances de travail. Cela a très vite fonctionné entre eux, il y avait une vraie reconnaissance du travail des deux côtés. Chacun laissait de la place à l’autre, permettant cette « fusion respectueuse ».
Vos personnages principaux sont presque toujours masculins. Comment l’expliquez-vous ?
Sans faire l’exégèse de mes films, je crois que cela relève d’un phénomène d’altérité. J’observe les hommes. En tant que femme, c’est un défi de parler de quelque chose qui m’intrigue, qui m’est étranger. Cela m’est apparu d’une manière assez évidente dès mes débuts dans le cinéma. J’aime beaucoup la fragilité des hommes. J’aime leur présence physique. Dans cette force, c’est la fêlure qui m’intéresse. C’est un mystère que je fouille, que je sonde.
Vos personnages sont souvent des étrangers ou des marginaux, au seuil de la légalité. Ils évoquent une problématique du monde contemporain, en portent les stigmates. C’est toujours un enjeu important.
Considérez-vous vos films comme politiques ?
Les destins de mes personnages sont des destins individuels. Ils ne constituent en aucune manière des généralités. C’est vrai, souvent, mes héros, qu’ils soient des citoyens français ou des étrangers, sont déracinés, ils n’ont pas de parenté, sont dépourvus d’attaches, et évoluent dans un monde qui, au mieux, ne les regarde pas, au pire les rejette. Je me sens en empathie avec ce genre de personnages, qui cherchent un endroit où se poser et vivre en harmonie avec eux-mêmes. Probablement parce que, dans mon parcours personnel, j’ai cherché à m’inventer moi-même, plutôt que de me réclamer d’une origine particulière, qui me fermait au monde. J’ai cherché à me construire, notamment à travers le cinéma. Cela a été un moyen de formation essentiel.
Après, en tant que cinéaste, j’observe, j’essaie de décrire un univers donné, certains aspects du fonctionnement de notre société : que devient un légionnaire étranger qui se retrouve sans permis de séjour en France ? Que devient un militaire blessé au combat ? Qu’est-ce qu’il advient d’un enfant qui se retrouve sans famille ? A chaque fois, ces personnages se heurtent à un système implacable, absurde, qui les fige dans une identité donnée (le Sans Papiers, le Mineur Isolé Etranger) et les isole. J’essaie juste de décrire ce phénomène de déshumanisation. Et de montrer, avec ce film, des personnages qui résistent, qui restent droits, humains et déterminés.
Vos personnages sont également dans la transgression.
Le récit initial en Afghanistan passe par la transgression des ordres. À sa sortie de la Légion, Markov est dans une
situation illégale malgré lui. Je veux épouser la dynamique intérieure des personnages, même en situation de transgression, et sans porter un jugement sur eux. Je suis de leur côté, car je suis toujours du côté de ceux qui veulent se sentir vivre, plutôt que de se sentir enfermés, engoncés, là où la vitalité ne peut pas s’exprimer. Ce sont des héros qui se heurtent à un monde qui ne les laisse pas vivre.
Vous filmez pour la première fois une figure d’enfant.
Dans le texte original du mythe de Gilgamesh, il n’y a pas d’enfant.
Dès l’écriture, l’idée de paternité planait. Au bout d’un moment, l’enfant s’est imposé. Par sa présence, il indique un choix de vie, prolongeant l’idée de la mortalité, du fait d’être homme. L’enjeu des personnages est, plutôt que d’accomplir des actes héroïques, d’élever un enfant, révélant ainsi l’humanité des deux personnages adultes.Le personnage de Markov est déjà un homme, il a fait la Légion afin de se permettre une vie avec son enfant en France. À l’inverse, Hamilton se cherche. Il annonce à Khadji qu’il ne peut pas s’occuper de lui, parce qu’il est un héros, un guerrier. L’enfant, tenace, se dit aussi qu’il est un héros. Il force Hamilton à se rendre compte que l’héroïsme se situe plutôt dans le fait d’accepter son destin, et non pas de le repousser plus loin, de l’écarter d’une main. Pendant l’écriture, j’ai beaucoup pensé à l’enfant d’UN ROI À NEW YORK. Cet enfant, fils de communistes, recueilli par Chaplin, qui exprime avec énormément de conviction le credo hérité de ses parents, et qui se retrouve soudainement face à l’adversité du monde dans lequel il vit. La détermination contre le monde.
C’est une vision de l’enfance que je trouve bouleversante. J’ai plus pensé au ROI À NEW YORK qu’au KID, qui pourrait constituer une référence plus évidente.

Les deux adultes ne peuvent pas atteindre une complétude sans l’enfant. Si Hamilton n’assume pas cette part de paternité qui surgit, il ne peut être homme. Markov est entier lorsqu’il a l’enfant à ses côtés.
Tout est interconnecté, oui. Cela pose les personnages sur un même plan. Il y a l’illusion que l’enfant est une charge pour Hamilton, mais qui ne dure pas. Il sent ce que l’enfant lui apporte : son humanité, sa véritable identité. Cela fonctionne dans les deux sens.
L’idée de la transmission apparaît : qu’est-ce que Markov et Hamilton transmettent ? Ce sont des petits gars qui ont des problèmes de papiers. L’un s’est pris une balle, il fait du footing sur un tapis roulant pour se remettre en forme. Vu à travers le regard de l’enfant, ce sont des géants, des héros. Cet imaginaire-là aide l’enfant à sortir
de cette situation terrible. C’est par là qu’il s’en sort. Cette idée me plaisait beaucoup. Une autre réminiscence cinéphilique est l’enfant des CONTREBANDIERS DE MOONFLEET. La phrase finale du film « L’exercice a été profitable » aurait très bien pu être prononcée par Hamilton. Dans le scénario, il n’était pas prévu que l’enfant
apparaisse au début, qu’il englobe ainsi le film et raconte l’histoire rétrospectivement, depuis Marseille. Le film s’ouvrait sur une scène de guerre, assez réaliste et classique. Or, pour des raisons de financements insuffisants, cette scène d’ouverture n’a pas pu se tourner comme on l’entendait. C’était de l’action, et cela coûtait très cher. Quand on s’est retrouvé avec l’unique possibilité de tourner deux jours au Maroc, pour un nombre de plans assez restreint et avec moins de décors naturels que prévu, il a fallu trouver une solution. J’ai opté pour cette ouverture en voix off qui me permettait de poser les personnages, mais aussi de situer leurs exploits dans une espèce de temps suspendu, différent de celui du film. Cela lui donne finalement une structure circulaire, atemporelle qui a un rapport ténu au mythe. C’est une histoire qu’on se raconte, que l’enfant nous raconte. Qu’Hamilton et Markov ont raconté. Qui se transmet. C’est toujours la même histoire. Le fait que ce soit un enfant qui raconte, c’est aussi l’enfance de l’humanité.
Il y a deux Paris qui coexistent. Un Paris immortel, monumental, lorsque Hamilton entre à moto dans la ville et celui plus gris, des petits cafés, des territoires de banlieue. Des commissariats.
La luminosité très forte qui ouvre et ferme le film, en Afghanistan et à Marseille était indispensable. Je me suis dit, pour avoir vécu vingt ans à Paris, que le noyau du film, lui, pouvait être filmé sans problème avec une lumière tourmentée. Que ce serait payant et juste.Paris est presque un personnage. Je voulais faire un film dans Paris. Représenter un « lieu de puissance », vu depuis l’étranger. Un lieu de liberté. Mais un lieu désincarné aussi. Un peu froid. Du point de vue des personnages, Markov allait évidemment vivre dans un quartier populaire. Mais en tant qu’étranger, comme tout le monde, il visite la capitale. Il découvre la ville dans laquelle sa femme a toujours désiré habiter et emmène son fils avec lui dans ce paradis pétrifié. J’ai choisi de montrer un Paris classique, que j’aime beaucoup esthétiquement. Que je trouve beau, majestueux, mais figé. La succession de statues qui accompagne l’entrée d’Hamilton dans la ville a été pensée avec Laurent Desmet comme en opposition avec le monde vivant et mythologique de l’Afghanistan, avec le léopard, vivant et sonore. Là, tout est figé dans une grandeur passée, formolée.
Il y a deux hommes, un enfant au milieu. On est en 2014…
La figure du militaire, du légionnaire fait partie d’un imaginaire homosexuel. On aurait pu penser à une relation plus ambivalente entre Hamilton et Markov, sans forcément que ce soit dit. Mais ça ne m’intéressait pas. Avec ce film, je souhaitais juste raconter une amitié masculine, sans ambiguïté. J’étais à Lisbonne quelques temps auparavant, pendant l’écriture, et une image m’est restée. Je me baladais dans la rue et sur la terrasse d’un café, j’ai aperçu deux hommes, assez âgés. L’un baignait ses pieds endoloris dans une bassine d’eau froide. L’autre était à genoux, lui lavant les pieds. C’était un geste amical, de prévenance, qui m’a profondément touchée. Je crois que c’est après cela que j’ai écrit la scène où Markov s’agenouille devant Hamilton pour lui refaire son lacet, avant le départ. C’est un geste de proximité physique sans ambigüité. Purement amical.